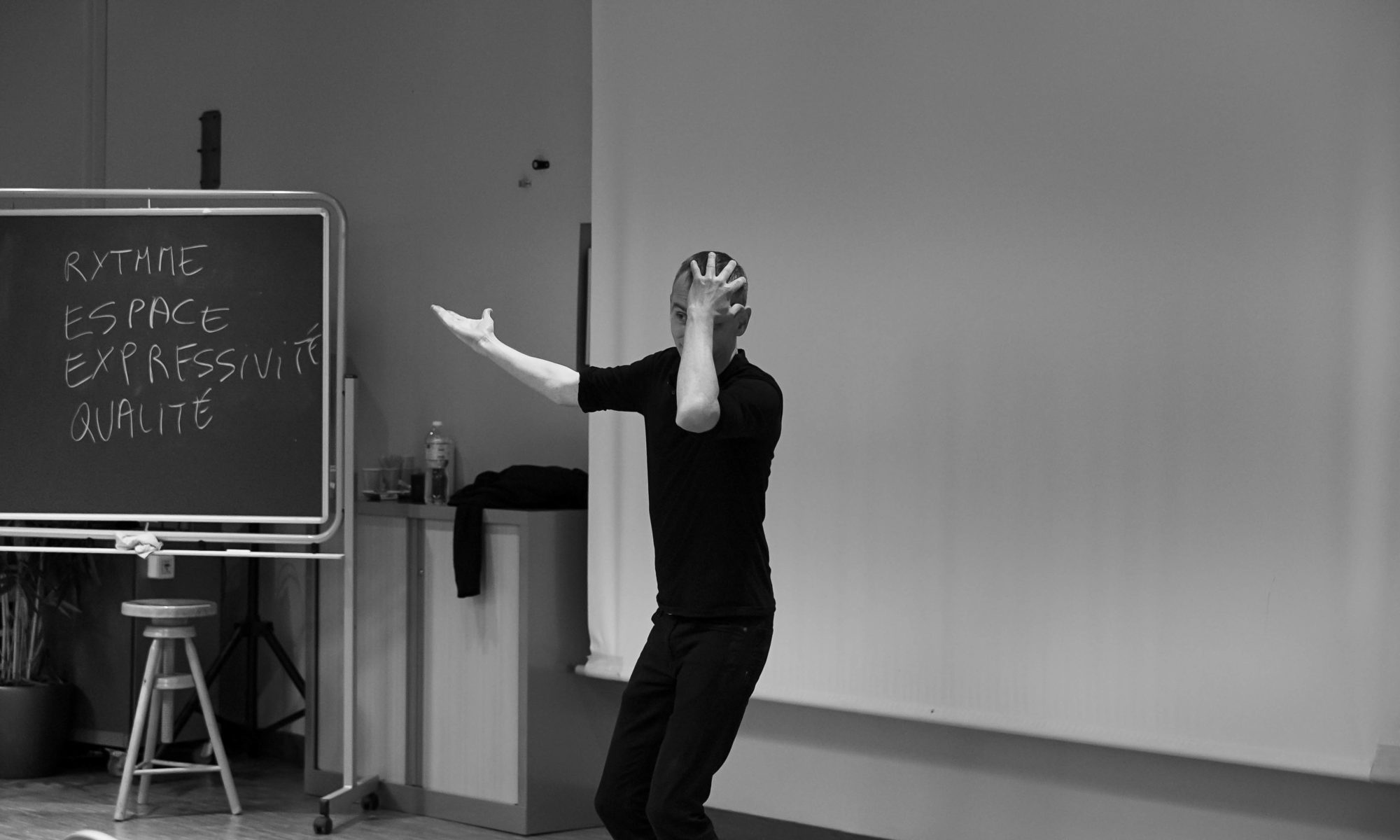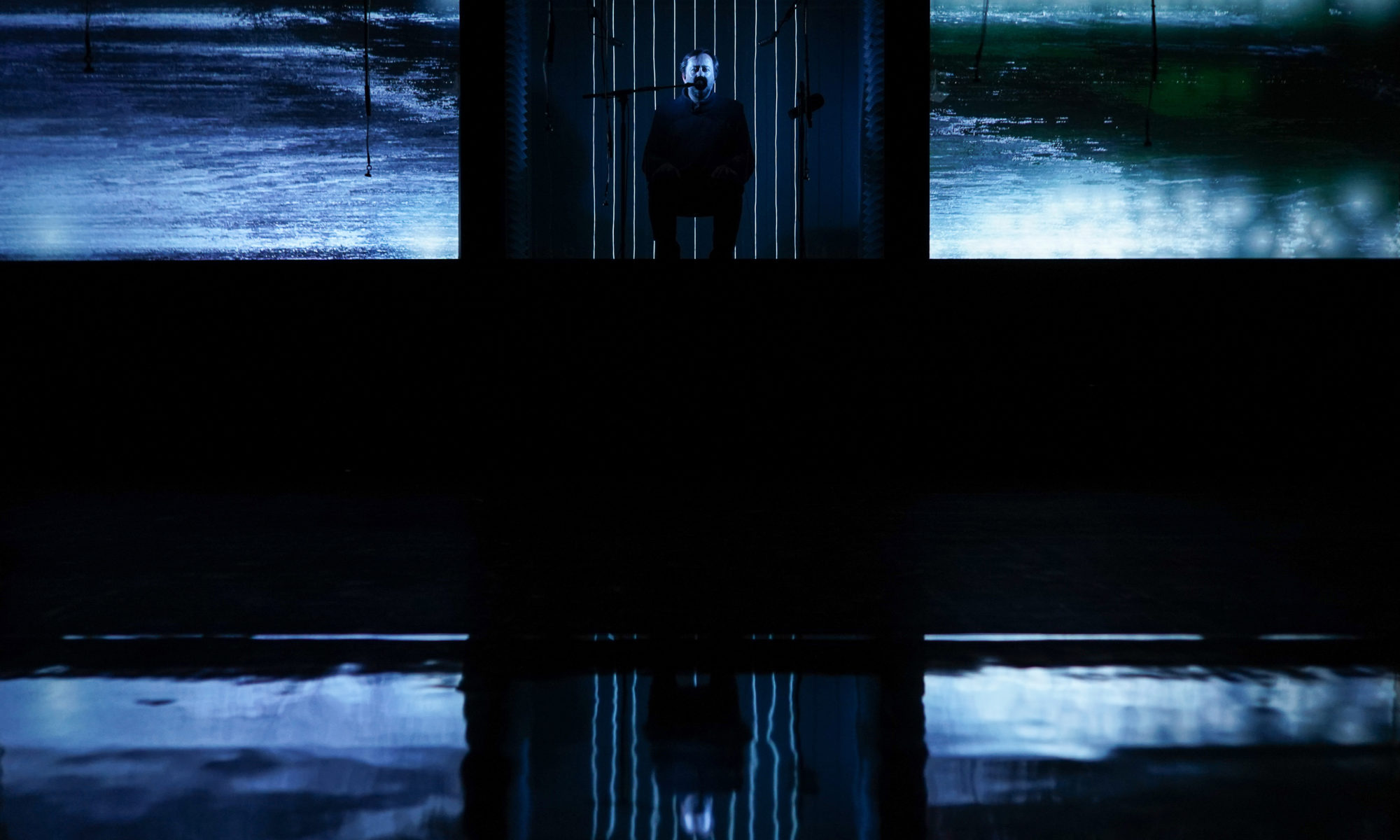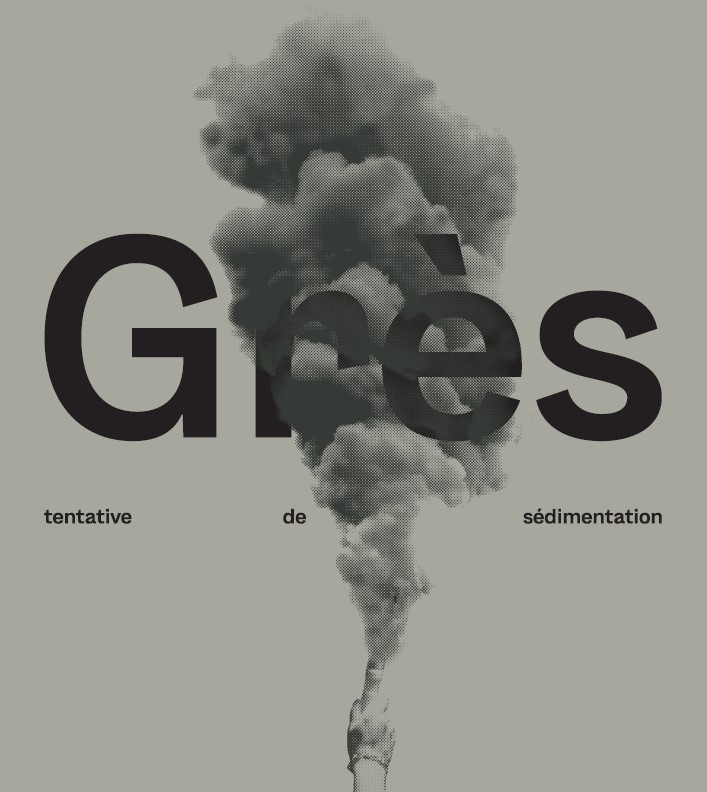CREATION LE 10 MARS 2022 A LA MC 93 – BOBIGNY
Album autobiographique de Chen Jiang Hong paru en 2008 à l’Ecole des Loisirs sous le titre Mao et Moi, Le petit garde rouge retrace le parcours d’un enfant chinois pris dans la tourmente de l’Histoire. Alors qu’il coule une enfance paisible auprès de ses parents, grands-parents et sa sœur sourde-muette, sa vie est bouleversée par l’arrivée de la Révolution Culturelle.
Cet épisode affleurait déjà dans Les Contes Chinois, précédente adaptation de deux autres ouvrages de Chen Jiang Hong par François Orsoni : « Le Prince tigre est déjà une métaphore de l’exil, l’histoire d’un enfant parti seul se confronter à un monde hostile, tandis que Le Cheval magique de Han Gan raconte l’histoire d’un enfant qui s’émancipe à travers l’art. Nous avions déjà là deux éléments essentiels de la vie de Chen.
Le petit garde rouge — traduction littérale du titre chinois — se place à ce moment précis où tout bascule. ». Violence, spoliation, propagande, humiliation… Chen assiste avec ses yeux d’enfant à l’éclosion d’un monde où l’on brûle les livres et détruit les souvenirs, révolution longtemps idéalisée par le monde Occidental.
« J’ai découvert le travail de Chen sur une vidéo dans laquelle on le voyait dessiner devant des enfants. L’énergie qu’il dégageait m’avait beaucoup ému. La puissance du dessin fascinait ces enfants, médusés, concentrés, hilares autour de lui… C’est à partir de ces quelques images que je suis allé vers ses livres. » François Orsoni
« Le petit garde rouge est extrêmement important pour moi. C’est un livre très personnel, dans lequel je retrace l’histoire de la Chine à travers celle d’un enfant. Je pense qu’il est de mon devoir de transmettre ce récit aux jeunes générations, afin qu’elles puissent mieux comprendre la Chine d’aujourd’hui, mais aussi comment cet épisode a durablement marqué le 20ème siècle. » Chen Jiang Hong